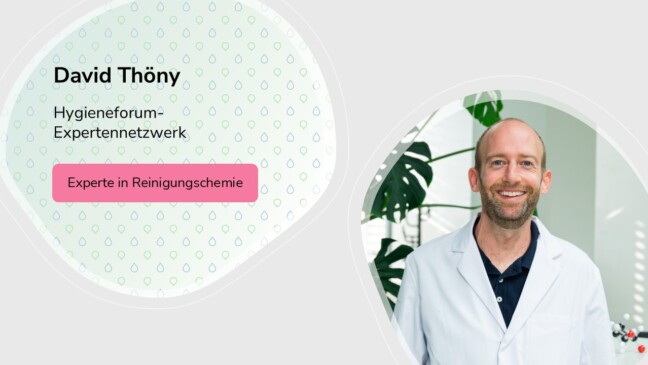
28.10.25
Des services de secours à l’hygiène hospitalière : René Böhmerle parle des défis et de l’avenir de la prévention des infections
René Böhmerle, membre du réseau d'experts Hygieneforum.ch, a suivi un parcours impressionnant, passant des services de secours aux soins intensifs, puis à l'hygiène hospitalière. Aujourd'hui, il conseille les établissements de santé dans la mise en œuvre de concepts d'hygiène efficaces et met en garde contre les risques sous-estimés liés au manque de conformité et aux agents pathogènes multirésistants. Dans cet entretien, il explique pourquoi la prévention est indispensable, quels sont les défis auxquels les hôpitaux doivent actuellement faire face et comment les nouvelles technologies vont changer la prévention des infections.
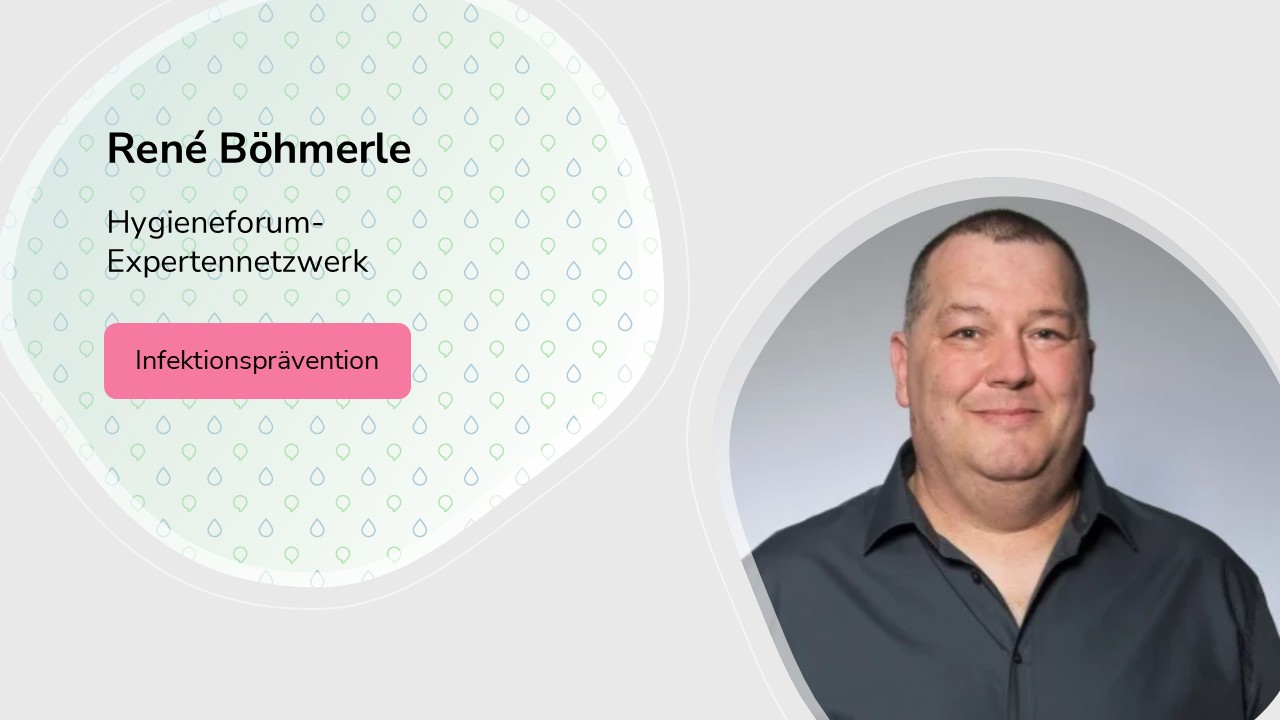
René Böhmerle est expert en prévention des infections dans le secteur de la santé (HFP) titulaire d’un diplôme fédéral et dispose d’une longue expérience dans le domaine hospitalier, en particulier en médecine intensive/IMC et en anesthésie. Après avoir suivi une formation en gestion et occupé des fonctions de direction en 2007, il s’est spécialisé en 2015 dans la prévention des infections. Aujourd’hui, René Böhmerle accompagne, par l’intermédiaire de la société B&B Hygieneberatung GmbH, les établissements de santé dans le développement et la mise en œuvre de concepts d’hygiène pratiques, réalise des audits et aide les équipes à intégrer durablement la prévention des infections dans le quotidien clinique.
Monsieur Böhmerle, vous avez suivi un parcours allant du quotidien clinique au conseil. Pouvez-vous nous décrire brièvement votre parcours et ce qui vous a motivé à vous spécialiser dans l’hygiène et la prévention des infections ?
Très tôt, j’ai su que je voulais exercer un métier qui me permettrait d’aider les autres. À 14 ans déjà, je m’engageais comme pompier volontaire dans ma ville natale.
Ma carrière professionnelle a débuté en 1987, lorsque je me suis engagé pour huit ans dans l’armée allemande. J’y ai suivi une formation d’ambulancier et travaillé aux urgences de l’hôpital militaire d’Ulm, où j’intervenais à bord de l’hélicoptère de sauvetage SAR Ulm 75. Après plusieurs années dans les services de secours, j’ai décidé en 1998 de suivre une formation d’infirmier. Je me suis rapidement rendu compte que les soins infirmiers classiques n’offraient pas suffisamment de diversité à mon goût et j’ai donc suivi une formation spécialisée en anesthésie et médecine intensive. L’occasion s’est alors présentée de diriger un service de soins intensifs, ce qui m’a amené à suivre une formation en gestion spécialisée dans l’organisation et la direction dans le domaine social.
En 2007, j’ai eu l’opportunité de créer un service de soins intermédiaires à l’hôpital cantonal de Baden en tant que chef de service. Une fois cette mission accomplie, je me suis orienté vers l’hygiène. Ma femme travaillait déjà dans ce domaine, ce qui m’a permis d’acquérir une première expérience et de développer mon intérêt pour la prévention des infections. C’est cette motivation qui m’a finalement poussé à passer l’examen professionnel supérieur d’expert en prévention des infections dans le domaine de la santé. Le thème de l’hygiène m’accompagnait depuis longtemps et j’ai finalement été contaminé par la passion de ma femme pour la prévention des infections, une contamination qui, dans ce contexte, doit être considérée comme positive !
Défis actuels
Selon vous, quels sont actuellement les principaux défis auxquels sont confrontés les hôpitaux et les établissements de soins en matière de prévention des infections ?
À mon avis, la pénurie de main-d’œuvre qualifiée et le taux de rotation élevé du personnel, en particulier parmi le personnel soignant et les spécialistes de l’hygiène, constituent actuellement le plus grand défi. Cela entraîne une charge supplémentaire pour les équipes existantes et complique la mise en œuvre des mesures nécessaires pour garantir des normes de qualité et d’hygiène élevées. L’expérience montre que la barrière linguistique joue également un rôle important pour les collaborateurs dont l’allemand n’est pas la langue maternelle. Ceux-ci sont généralement très motivés, mais ont besoin de plus de temps pour se familiariser avec leur travail et recevoir des instructions en raison des problèmes linguistiques. La complexité croissante de la clientèle de patients due à la multimorbidité et aux transferts de plus en plus précoces vers des établissements de suivi tels que les cliniques de réadaptation, les maisons de retraite ou les services d’aide et de soins à domicile constitue un défi supplémentaire. Combiné aux facteurs déjà mentionnés, cela rend extrêmement difficile la mise en œuvre de mesures de prévention. La situation financière tendue et la pression sur les coûts qui en résulte dans de nombreux établissements exacerbent le conflit entre la rentabilité et les ressources nécessaires pour les mesures d’hygiène. Malheureusement, les calculs sont souvent très à court terme et ne tiennent pas compte du fait que la prévention coûte certes de l’argent, mais permet de réaliser d’énormes économies à long terme. Une discussion sur l’aspect éthique de cette question dépasserait le cadre du présent article…
Selon vous, quels sont les facteurs qui compliquent la mise en œuvre de mesures d’hygiène efficaces ?
Je citerais tout d’abord le manque de conformité. Malgré des directives claires, le respect des mesures standardisées, telles que l’hygiène des mains et les mesures d’isolement, n’est souvent pas garanti dans les situations stressantes ou en cas de charge de travail élevée.
Les interfaces entre les différents domaines, mais aussi entre les institutions, constituent un défi permanent. L’expérience montre qu’une communication et une collaboration interprofessionnelles insuffisantes entre les soins infirmiers, les thérapies, le corps médical, l’économie domestique, le nettoyage et la logistique conduisent souvent à des erreurs. En outre, les conséquences d’un manque de priorité accordée à l’hygiène par la direction et l’absence de rôle modèle qui en résulte sont souvent sous-estimées.
Agents pathogènes multirésistants
Comment évaluez-vous la situation actuelle en matière de gestion des agents pathogènes multirésistants ?
La situation est grave. Les stratégies NOSO et StAR de la Confédération constituent de très bonnes approches, mais elles ne sont pas encore largement mises en pratique. On perd ainsi un temps précieux et on a toujours un temps de retard sur le développement de nouvelles résistances. La mondialisation complique encore davantage la situation. La gravité de la situation est bien consciente. Cependant, les causes du problème sont multifactorielles et mondiales, ce qui rend difficile la coordination rapide et efficace des mesures prises par tous les acteurs impliqués dans la recherche d’une solution.
Selon vous, les institutions suisses sont-elles suffisamment préparées ?
Cela varie considérablement. Les hôpitaux universitaires et les grandes cliniques sont généralement bien préparés, disposent d’équipes d’hygiène hospitalière bien formées, de possibilités d’isolement et de capacités de laboratoire pour un dépistage rapide. Les petits hôpitaux sont souvent rattachés aux grandes cliniques et peuvent bénéficier de leur infrastructure et de leur expertise. Les établissements de soins de longue durée, en revanche, ont beaucoup plus de difficultés. Il existe relativement peu de données scientifiques dans ce domaine et l’offre de formation n’est pas adaptée à ce contexte. L’OFSP a reconnu ce problème et a donc étendu la stratégie NOSO aux établissements médico-sociaux. Dans le domaine ambulatoire, cependant, il reste encore beaucoup à faire. À mon avis, l’individualité des différents domaines (soins aigus, soins de longue durée et soins ambulatoires) doit être davantage prise en compte dans la mise en œuvre des mesures.
Évolutions technologiques
Quel rôle jouent les nouvelles technologies telles que les systèmes de surveillance numériques ou les robots de désinfection dans la prévention des infections ?
Les nouvelles technologies jouent un rôle de plus en plus important dans la prévention et le contrôle des infections, mais elles ne doivent pas être surestimées. Les lacunes des différents systèmes doivent être soigneusement évaluées. Par exemple, les zones non couvertes par les rayons UVC lors de la désinfection ou les erreurs possibles dans l’hygiène des mains, lorsque, par exemple, un désinfectant pour les mains est prélevé à tort d’un distributeur destiné à la désinfection des surfaces. Le contrôle définitif doit donc rester entre les mains de l’homme. Actuellement, ces technologies sont généralement associées à des coûts élevés, ce qui explique pourquoi elles ne peuvent être utilisées que par les grands hôpitaux. Mais en principe, tout ce qui facilite le travail et/ou ravive la conscience des mesures d’hygiène est positif.
Considérez-vous ces solutions comme indispensables ou plutôt complémentaires ?
Ces solutions sont actuellement complémentaires, mais deviendront indispensables dans un nombre croissant de domaines à l’avenir. Elles ne doivent toutefois pas conduire à négliger la responsabilité humaine.

René Böhmerle
Formation : Prévention des infections dans le domaine de la santé (HFP) avec diplôme fédéral, longue expérience dans le secteur hospitalier, en particulier en médecine intensive/IMC et en anesthésie ; formation en gestion et fonction de direction.
Actuellement: B&B Hygieneberatung
réseau d’experts: hygieneforum.ch/hygiene-experten/
Expériences pratiques
Vous conseillez de nombreux établissements : quelles sont les erreurs ou les idées fausses typiques que vous rencontrez régulièrement ?
La première chose qui me vient à l’esprit est le fiasco des gants : l’idée largement répandue selon laquelle le port de gants jetables remplace l’hygiène des mains. En réalité, une mauvaise utilisation des gants, sans désinfection correcte des mains et sans changement approprié, augmente considérablement le risque de contamination. La situation est également difficile lorsque, par exemple, les maisons de retraite, faute de ressources internes, appliquent les directives d’hygiène des hôpitaux, mais que celles-ci ne correspondent pas au profil de risque de l’établissement. On trouve souvent du matériel qui n’est plus hygiéniquement irréprochable en raison d’un stockage incorrect. De même, la séparation entre les zones sales et propres n’est souvent pas respectée dans les processus de travail ou est difficile à mettre en œuvre en raison des conditions spatiales. Je pourrais citer encore de nombreux autres points. Pour conclure, je voudrais mentionner une erreur de raisonnement fréquente. On se concentre presque désespérément sur la désinfection de toutes les surfaces, alors que les surfaces fréquemment touchées à proximité des patients (surfaces à contact élevé) et les aides aux soins, telles que les chaises de douche, ne sont souvent pas nettoyées et désinfectées avec suffisamment de soin.
Existe-t-il des mesures qui ont un effet immédiat et peuvent être mises en œuvre rapidement ?
Je recommande toujours de commencer par dresser un état des lieux à l’aide d’un audit d’hygiène. Cela permet d’identifier les lacunes existantes et de planifier les mesures à court et à long terme qui s’imposent. Une mesure qui peut être mise en œuvre relativement rapidement, mais qui apporte une amélioration considérable en matière d’hygiène des mains, consiste à remédier à l’absence de désinfectant pour les mains au point de soins. Des formations à l’hygiène pour tous les employés peuvent également être mises en place à court terme. Des instructions visuelles sous forme de pictogrammes, par exemple pour le chargement correct des distributeurs automatiques de bassins ou la désinfection correcte des mains, peuvent également être mises en place rapidement. Toutefois, pour obtenir un effet durable, un processus d’amélioration continue doit être planifié sur une plus longue période.
Regard vers l’avenir
Comment la prévention des infections va-t-elle évoluer au cours des 5 à 10 prochaines années ?
La numérisation et l’utilisation de l’intelligence artificielle vont jouer un rôle de plus en plus important. Il est souhaitable d’augmenter les mesures préventives et, par conséquent, de réduire les mesures réactives. Il convient de créer une culture de la sécurité qui ancre profondément la prévention des infections comme un élément important de la sécurité des patients à tous les niveaux hiérarchiques et dans tous les domaines concernés. Pour y parvenir, la sensibilisation à la prévention des infections doit commencer dès la formation.
Quelles tendances ou évolutions réglementaires les établissements doivent-ils surveiller ?
Il convient en premier lieu d’observer l’évolution dans tous les domaines des différents acteurs afin d’élaborer une stratégie commune. En ce qui concerne les évolutions réglementaires, les deux stratégies de la Confédération NOSO et StAR sont déterminantes. De plus, les mesures nationales de la qualité deviendront probablement obligatoires dans les maisons de retraite et les établissements médico-sociaux. Des indicateurs standardisés de prévention des infections, tels que le taux d’infections nosocomiales, le respect des règles d’hygiène des mains ou la consommation d’antibiotiques, seront mesurés et publiés. À l’instar des exigences structurelles minimales pour les hôpitaux, il existera à l’avenir des directives contraignantes pour les établissements de soins de longue durée, qui seront élaborées dans le cadre du plan d’action NOSO pour les établissements médico-sociaux.
Votre message et vos moments forts personnels
Si vous pouviez adresser un message central aux décideurs du secteur de la santé, quel serait votre appel le plus important ?
Mon appel le plus important aux décideurs du secteur de la santé : Il n’y a pas de gloire dans la prévention. Investissez quand même dans l’hygiène ! Non pas comme un facteur de coût, mais comme un pilier central de la sécurité des patients et de l’excellence opérationnelle. Les ressources consacrées à la prévention des infections, qu’il s’agisse d’un personnel bien formé ou d’une infrastructure adéquate, ne doivent pas être sacrifiées au profit d’économies à court terme. Une seule épidémie de grande ampleur peut réduire à néant les économies réalisées pendant des années. La prévention est plus rentable que le traitement des infections. La responsabilité d’une hygiène efficace incombe en premier lieu à la direction et doit être ancrée comme un objectif stratégique.
Y a-t-il un projet ou une initiative que vous aimeriez présenter à nos lecteurs ?
Oui, cela existe effectivement. Je suis actuellement en train de mettre en place un réseau pour la prévention des infections dans les établissements médico-sociaux. Conformément aux recommandations de l’OFSP, j’essaie de l’établir au niveau intercantonal. L’objectif est de réunir tous les acteurs tels que les établissements médico-sociaux, les autorités et les associations au sein d’un réseau afin de partager les ressources telles que les connaissances et les expériences, et ainsi de gagner du temps et de réduire les coûts pour chacun.










