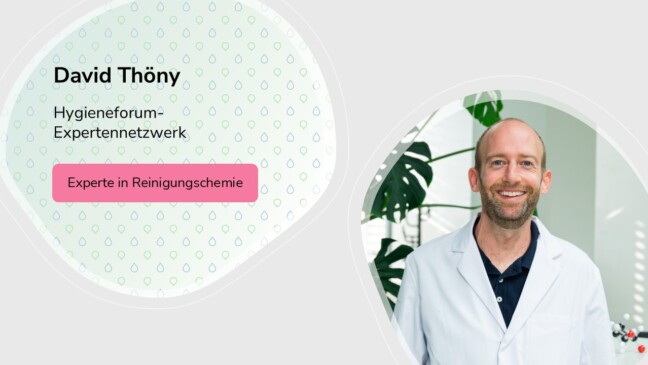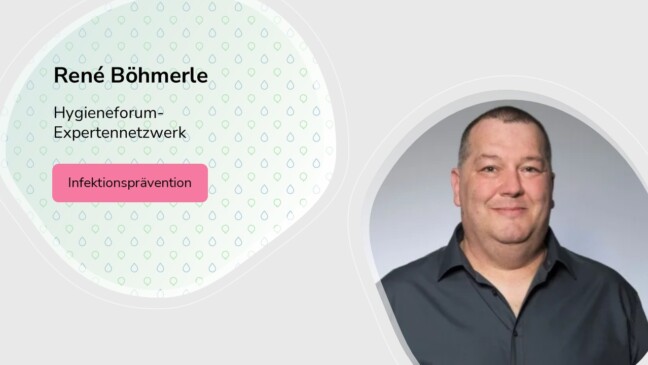17.09.25
Entretien avec Thomas Leiblein : pourquoi l’hygiène de l’eau mérite davantage d’attention
L'eau est l'aliment numéro un, et pourtant beaucoup sous-estiment les risques liés à un manque d'hygiène dans ce domaine. Thomas Leiblein, expert en hygiène de l'eau, de l'air et des surfaces, et membre du réseau d'experts du forum Hygieneforum.ch, explique pourquoi la prévention contre les légionelles est aujourd'hui plus importante que jamais et comment les entreprises peuvent renforcer leur résilience grâce à des audits ciblés.
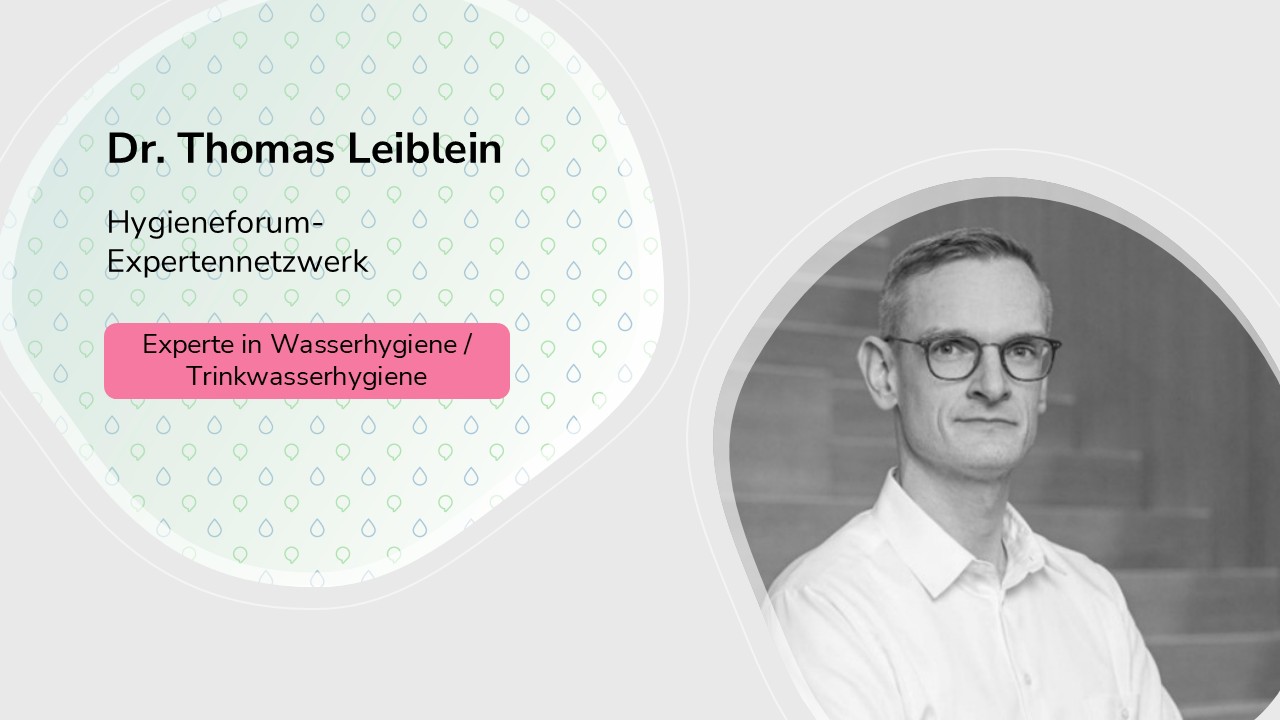
Thomas Leiblein est titulaire d’un doctorat en sciences de la vie et d’un diplôme d’ingénieur (FH) avec plus de 20 ans d’expérience dans le domaine de l’hygiène et de la prévention des infections. Après avoir occupé divers postes dans la recherche, l’enseignement et l’hygiène hospitalière, il a fondé en 2025, avec des partenaires, la société ewah AG – experts in water, air and hygiene. En tant que chef de projet et auditeur, il conseille les entreprises dans la mise en œuvre de concepts de sécurité de l’eau, réalise des audits d’hygiène et est considéré comme un expert reconnu en matière d’hygiène de l’eau potable et de prévention des légionelles.
Monsieur Leiblein, pouvez-vous nous présenter brièvement votre parcours professionnel et votre spécialisation dans le domaine de l’hygiène et de la prévention des infections ?
Je peux désormais me prévaloir de plus de 20 ans d’expérience dans le domaine de l’hygiène. Mes missions ont notamment consisté à élaborer et à mettre en œuvre des concepts d’hygiène, à traiter des questions spécifiques liées à la gestion des processus et des risques, à assurer le suivi et l’audit de l’hygiène, ainsi qu’à dispenser des formations initiales et continues. Mon intérêt pour l’hygiène s’est développé pendant mon service civil, lorsque je travaillais dans le service interne d’un hôpital dans le cadre d’un système de travail posté. Cela a influencé mon choix de carrière et a déterminé mon parcours de formation professionnelle. Les liens entre l’environnement vivant et inanimé, l’invisible (microbiologie, chimie, physique) qui influence la santé humaine, ont dès lors trouvé leur place dans des études pratiques à l’université technique, sanctionnées par un diplôme d’ingénieur (FH) en technologie alimentaire et hygiène, dans un établissement de formation approprié. Après un mandat dans le domaine du nettoyage de bâtiments au sein du groupe Dorfner à Munich, j’ai rejoint en 2008 l’Institut de gestion des installations de la ZHAW (Haute école des sciences appliquées de Zurich), où j’ai travaillé comme assistant aux côtés de Thomas Hofmann, un chimiste passionné, scientifique, hygiéniste du travail et expert en décontamination possédant une vaste expérience en gestion, sur des questions spécifiques liées à l’industrie, aux projets, à la R&D, mais surtout dans le domaine de la formation initiale et continue.
Après près de 10 ans passés à l’institut, le moment était venu de changer. Je me suis alors engagé directement dans le secteur de la santé, passant de la gestion des installations à une fonction spécialisée et de direction dans le domaine de l’hygiène hospitalière au sein du groupe hospitalier suisse Hirslanden, avec un accent particulier sur la gestion de la qualité et des risques. La collaboration et la direction technique des questions médicales sous la houlette du Prof. Dr Rami Sommerstein, excellent infectiologue et chercheur, ont été déterminantes à cet égard. Après trois ans passés là-bas, puis trois autres années au sein d’un groupe spécialisé dans l’hygiène de l’eau potable chez Vadea AG, un bureau d’études et d’ingénierie, j’ai eu l’opportunité, début 2025, de fonder la société ewah AG avec des collègues de travail. J’y travaille depuis comme chef de projet. En tant que société de conseil interdisciplinaire, indépendante et disposant d’un large éventail de compétences, nous proposons, en tant qu’« experts en eau, air et hygiène », des services dans le domaine du conseil aux maîtres d’ouvrage, de l’hygiène de l’eau, de l’air et des surfaces. Notre expertise dans le domaine de l’hygiène de l’eau potable est unique en Suisse grâce à notre équipe de spécialistes.
Qu’est-ce qui vous a motivé à vous concentrer sur l’hygiène de l’eau et la prévention des légionelles ?
L’eau est l’aliment numéro un. Sans eau, l’être humain ne survit pas longtemps et, d’un point de vue purement biologique, n’est pas grand-chose. Quiconque souhaite préserver sa santé doit mener une vie saine à différents niveaux. Mais certains facteurs, notamment liés à l’eau potable, peuvent entraîner des infections et des maladies. Dans ma thèse de doctorat, je me suis intéressé à l’hygiène de l’eau potable dans les bâtiments du secteur de la santé de différents pays. Au cours de mes recherches sur ce sujet, j’ai constaté à plusieurs reprises que, d’une part, les structures de gestion des entreprises et, d’autre part, l’organisation et l’accès aux connaissances spécialisées ainsi que la mise à disposition des ressources nécessaires (par exemple, la mise en œuvre de travaux d’entretien réguliers et périodiques) sont des facteurs décisifs pour déterminer si et dans quelle mesure les exigences (changeantes) applicables aux domaines responsables des installations d’eau potable sont prises en compte et satisfaites. J’ai donc défini précisément ces niveaux d’observation comme titre de recherche : « Gestion de la sécurité de l’eau, prévention des légionelles et gestion des risques dans les hôpitaux : un cadre pour la gestion immobilière et des installations en Angleterre ». Grâce à ma propre position d’expert et de cadre dans un établissement de santé suisse, j’étais littéralement à la « source » des événements et j’ai pu relever les défis des processus de gestion et de changement nécessaires dans la réflexion et l’action, afin d’améliorer la sécurité des processus dans le domaine de l’autocontrôle obligatoire.
Qu’entend-on par hygiène de l’eau et quels sont les thèmes abordés par l’hygiène de l’eau ?
L’hygiène de l’eau est un vaste domaine, tout comme le parcours de l’eau depuis sa source jusqu’au consommateur final. Dans les entreprises qui fournissent différentes qualités d’eau aux utilisateurs, l’eau peut être soumise à différentes exigences de qualité. Il est tout d’abord nécessaire de savoir à quelle fin / pour quel processus / pour quel usage l’eau est nécessaire. Grâce à des étapes de traitement techniques et à des installations appropriées, les critères imposés à l’eau peuvent être influencés de manière à ce que les paramètres chimiques, microbiologiques et physiques puissent être ajustés aux valeurs cibles ou aux plages de tolérance. Cependant, il faut toujours garder à l’esprit deux choses :
- L’eau potable n’est pas une eau stérile
- Si l’on influence la qualité de l’eau, les propriétés chimiques, microbiologiques et physiques de l’eau changent inévitablement.
De tels changements, qu’ils soient provoqués intentionnellement ou causés par des installations défectueuses, peuvent entraîner une perte de qualité, voire des risques (techniques, liés aux installations ou aux produits) pouvant aller jusqu’à des dangers pour la santé.
L’objectif de l’hygiène de l’eau est donc de contrôler et de réguler la qualité de l’eau dans le cadre d’une approche globale multifactorielle, de manière à éviter tout risque pour la santé et à garantir le bon fonctionnement des processus (conformément à leur conception et à leur planification).
Quelle est aujourd’hui l’importance de l’hygiène de l’eau et en particulier de la prévention contre les légionelles ?
L’hygiène de l’eau prend de plus en plus d’importance. Nous le constatons dans de nombreux domaines. En particulier dans celui de l’hygiène de l’eau potable. D’une part, les prescriptions relatives aux exigences en matière d’hygiène de l’eau potable ont été renforcées ces dernières années et continuent de l’être actuellement. Je citerai ici, par exemple, la large reconnaissance des questions d’hygiène et des normes et directives correspondantes dans le secteur de la planification et de la construction, ou encore l’adaptation des modules OFSP OFAE « Recommandations relatives aux légionelles et à la légionellose ». D’autre part, de plus en plus de questions se posent en rapport avec l’hygiène de l’eau, ce qui s’explique également par la pénurie de main-d’œuvre qualifiée, la modification des chaînes d’approvisionnement, l’augmentation des coûts des constructions durables et la modification des conditions climatiques. Les légionelles se développent là où elles trouvent des conditions favorables. C’est le cas à des températures comprises entre 25 °C et 45 °C (voire légèrement supérieures) et lorsque l’apport en nutriments est suffisant. Mais d’autres facteurs entrent également en jeu, de sorte que les « stratégies quotidiennes » couramment utilisées pour endiguer la contamination des installations d’eau potable ne sont parfois que partiellement efficaces. Les entreprises devraient davantage se tourner vers une approche préventive assortie de mesures concrètes afin de mettre en place une stratégie (sûre) efficace à long terme. Les maîtres d’ouvrage, architectes, propriétaires, bailleurs et locataires continuent parfois d’ignorer ou d’être incertains quant aux risques sanitaires et aux obligations d’autocontrôle, voire d’adopter une attitude néfaste pour la réussite en raison d’un schéma de pensée négatif selon lequel « cela ne posait pas de problème auparavant ».
Outre la gestion de projet, vous proposez également des audits d’hygiène. Quelle est l’importance de ces audits d’hygiène et comment se déroulent-ils ?
Nos audits couvrent le domaine de l’hygiène environnementale. Nous distinguons trois modules, à savoir l’hygiène de l’eau potable, l’hygiène de l’air et l’hygiène industrielle, qui comprend par exemple l’hygiène classique des surfaces. Lors de nos audits, nous vérifions la robustesse des concepts d’hygiène existants dans le cadre d’un contrat et identifions les potentiels d’optimisation. L’objectif est que les responsables dans les entreprises alignent (ou réalignent) leurs concepts d’hygiène sur l’état actuel de la technique. Les audits se déroulent en plusieurs étapes et commencent par un entretien préliminaire et une étude préalable des documents (documents de planification, documents de processus, rapports d’essai, etc.). Ils sont suivis d’une brève série d’entretiens et d’une visite des lieux. Un rapport est ensuite établi et discuté avec les responsables et la direction afin de présenter la situation initiale de manière transparente (analyse des écarts / identification des non-conformités / discussion des mesures à prendre). Ces audits externes permettent aux entreprises de renforcer leur résilience. Elles affinent leurs propres compétences dès la phase d’audit.

Dr. Thomas Leiblein
Formation : Doctorat, Master ZFH en sciences de la vie, ingénieur diplômé (FH), spécialité : hygiène
Actuellement : chef de projet, auditeur chez ewah AG – experts en eau, air et hygiène
Réseau d’experts :hygieneforum.ch/hygiene-experten/
Dans quels types de bâtiments l’hygiène de l’eau et, par conséquent, un concept de sécurité de l’eau sont-ils particulièrement importants ?
En principe, l’hygiène de l’eau est un sujet qui concerne tous les types de bâtiments. Dans la directive W3/E4 de la SSIGE, qui décrit l’autocontrôle des installations d’eau potable dans les bâtiments selon l’état actuel de la technique, le tableau 1 établit une distinction entre différentes catégories de bâtiments. Il n’est pas surprenant que les établissements de santé, tels que les hôpitaux et les maisons de retraite et de soins, soient soumis à des intervalles de contrôle plus fréquents que d’autres catégories de bâtiments, tels que les hôtels/établissements d’hébergement, les installations scolaires et sportives et, de manière générale, les espaces publics équipés de douches. En effet, ces lieux accueillent un nombre croissant de personnes vulnérables et/ou immunodéprimées, particulièrement sensibles aux infections causées par des agents pathogènes présents dans l’eau.
Tous les types de bâtiments ont en commun une utilisation prévue et conforme à leur destination. L’inventaire des risques potentiels liés à l’installation d’eau potable, ainsi que les contrôles de routine concernant le fonctionnement, la température et la microbiologie (p. ex. légionelles), associés à l’entretien des installations et des appareils, constituent les principes fondamentaux de l’autocontrôle. Dans la relation propriétaire-locataire, il existe également des obligations réciproques à respecter. Un concept d’autocontrôle contraignant et fondé est donc indispensable.
Quels sont les principaux défis liés à la mise en œuvre des concepts de sécurité hydrique ?
De manière générale, le plus grand défi consiste à sensibiliser et à conscientiser les parties prenantes (par exemple lors d’un projet de planification et de construction) et les responsables d’exploitation aux risques éventuels. En outre, des mesures concrètes, raisonnables sur le plan opérationnel et cohérentes, qui répondent aux exigences d’une situation initiale (problématique), jouent un rôle important. Personne n’aime s’occuper de problèmes potentiels et peut-être même coûteux. Il faut donc une communication indépendante, adaptée au public cible, et une empathie professionnelle. Elle est indispensable. Dans le cadre de nos services, nous nous considérons comme des médiateurs ou des ambassadeurs et sommes habitués à communiquer à différents niveaux hiérarchiques et avec des profils professionnels variés. Néanmoins, la responsabilité incombe aux entreprises, aux responsables et aux décideurs eux-mêmes.
Pouvez-vous citer un exemple tiré de votre pratique où un audit d’hygiène a permis de mettre au jour des problèmes ou des dangers jusque-là inconnus ?
Je me souviens d’un audit réalisé il y a quelques années dans un centre médical spécialisé dans la médecine reproductive. Après un entretien préliminaire, l’intérêt de faire appel à un expert externe est apparu clairement. Le contenu de l’audit a été classé selon différents niveaux d’analyse. Les documents disponibles ont été consultés afin de se familiariser avec les processus existants. Bien que le centre ait mis en place des processus sophistiqués et bien conçus dans le domaine de l’hygiène et du traitement, des problèmes ont néanmoins été mis en évidence. Les locaux étaient loués. Au cours de l’audit, des dépassements des valeurs maximales microbiologiques ont été constatés dans l’installation d’eau potable, qui concernaient même le système d’eau froide et se répercutaient jusqu’au distributeur d’eau potable installé sur le réseau d’eau froide. Outre l’utilisation problématique sur le plan hygiénique de la douche du personnel, il s’agit là d’un écart grave par rapport à la situation souhaitée. La « limite du système » et la relation propriétaire-locataire ont dû être clarifiées dans le domaine de l’approvisionnement en eau potable interne au bâtiment, et la répartition des rôles en matière d’autocontrôle pour la planification des mesures nécessaires et la communication sur la qualité insuffisante de l’eau a dû être définie. Des lacunes comparables dans les concepts d’hygiène et l’absence de mesures nécessaires peuvent également être constatées dans les situations d’approvisionnement, par exemple dans les cabinets dentaires ou les cabinets médicaux loués dans des bâtiments hospitaliers.
Quelles tendances voyez-vous se dessiner dans les prochaines années dans le domaine de l’hygiène de l’eau et de la prévention des infections ?
Je ne souhaite pas parler ici de tendances, car à mes yeux, celles-ci ont une durée de vie limitée, un caractère peu contraignant et contribuent rarement à une action responsable à long terme. La plupart du temps, elles sont soit issues d’un gain de connaissances unilatéralement approuvé, soit d’une recherche radicale ou imprudente du succès ou du profit. Au détriment de ceux qui y sont sensibles. Je vois les défis actuels et à venir et j’essaie, avec des personnes partageant les mêmes idées, de m’y préparer et de trouver des solutions. Les grands thèmes généraux seront la disponibilité à long terme de l’eau potable, une ressource saine, et l’accès à celle-ci – des thèmes certes très globaux, tels qu’ils sont reconnus par l’OMS. Mais la gestion des eaux usées joue également un rôle important. Il en va de même pour les défis auxquels la société est confrontée avec l’augmentation de la résistance aux antibiotiques. Je renvoie à cet égard aux stratégies de la Confédération dans son plan d’action One Health StAR 2024-2027 et aux exigences structurelles minimales pour la prévention et la lutte contre les infections associées aux soins de santé (IAS) dans les hôpitaux suisses de soins aigus.
Qu’est-ce qui vous motive personnellement à rester actif dans ce domaine ?
Même si le thème des énergies renouvelables me concerne plus que jamais, il y a cette citation célèbre du groupe pétrolier Esso datant des années 70 qui dit : « Il y a beaucoup à faire, alors mettons-nous au travail ! ». Depuis que j’ai choisi ma profession, je me sens engagé envers le thème de l’hygiène, c’est-à-dire la santé. Contrairement à « l’eau vive », qui n’est décrite que dans la Bible et qui fait du bien à mon âme, mon domaine d’activité me donne un sens à ma vie professionnelle.
Contributions de Thomas Leiblein publiées dans le hygieneforum